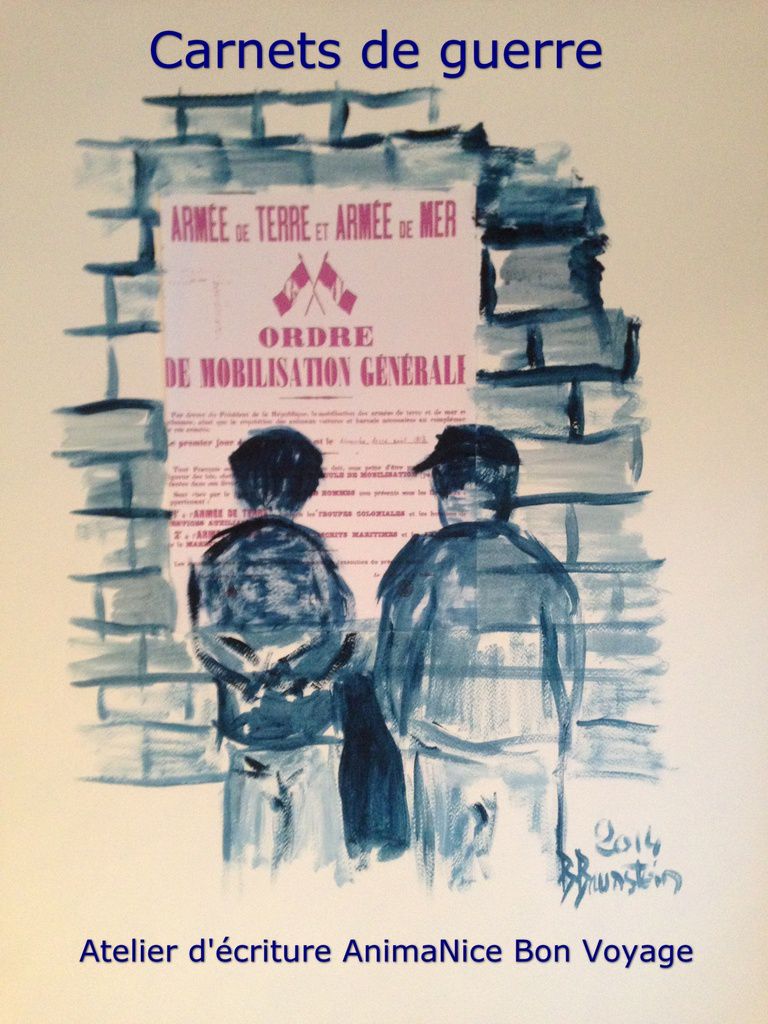PRISE DE CONSCIENCE
Jeune infirmière dans sa blouse blanche, elle ne connaît de la guerre que ce que le journal en rapporte. Jusqu’au jour où elle est appelée pour servir à l’Hôtel Regina, transformé pour un temps en hôpital.
En arrivant, elle est saisie par les odeurs d’alcool et de teinture d’iode qui envahissent toutes les pièces de l’hôtel. Les blessés sont partout, la vue de toute cette jeunesse à qui il manque un bras, une jambe lui soulève le cœur. Il faut pourtant être opérationnelle, pas le temps de laisser parler les sentiments. En une seule journée, elle examine plus de trente blessés. À chacun elle apporte son soutien, change des pansements, aide un amputé des deux bras à manger son repas. Emmène sur la terrasse, un jeune chasseur gazé afin qu’il respire l’air vivifiant de la méditerranée. Une simple caresse pour sécher les larmes d’un officier devenu aveugle, rédiger une lettre d’amour d’un soldat à la gueule cassée. Une journée où elle vieillit prématurément devant l’horreur de l’inutile. Son métier d’infirmière se transforme en assistante du malheur. Savoir écouter, regarder en essayant d’expliquer du haut de sa jeunesse à des hommes perdus, que la vie demain sera belle.
Le soir en rentrant chez elle, elle se met à pleurer.
Bernard B.
…..
MARRAINE DE GUERRE
J'ai vu l'annonce dans le journal : des soldats recherchent des marraines de guerre. J'ai eu tout de suite envie de postuler. Ma candidature acceptée, me voilà marraine de Félix, soldat sans famille qui se bat à Verdun.
Je ne sais pas grand-chose de lui ; ma première lettre est un peu impersonnelle, je l'avoue. Je lui raconte mon quotidien d'institutrice, les bêtises de mes élèves... J'essaie de lui apporter un peu de légèreté. Son quotidien à lui doit être si lourd...
J'ai glissé ma lettre dans un colis de friandises. J'espère qu'il appréciera. Depuis l'envoi du colis, j'attends. J'ai hâte d'avoir une réponse ! Les jours passent ; Fernand, le facteur, ne s'arrête jamais devant ma maison. Je désespère et surtout, je m'inquiète pour lui. Est-il toujours vivant ? A-t-il reçu ma lettre ?
Ce matin, enfin, Fernand s'immobilise devant ma boîte. Il n'a pas eu le temps d'y insérer le courrier que je suis devant lui, main tendue. Un missive froissée, maculée de boue y tombe. Mon cœur s'accélère. Je l'examine, la flaire, l'apprivoise avant de l'ouvrir.
Une écriture un peu hachée me salue - Chère Marraine...
La suite, je ne vous la lirai pas, elle m'appartient. Ce que je peux dire, c'est que Félix est très heureux d'avoir reçu mes friandises et encore plus d'avoir une marraine qui lui écrit. Il m'a envoyé sa photographie de beau militaire à la moustache conquérante. Il a mon âge, espère recevoir d'autres nouvelles de l'arrière et surtout de moi. Il me dit qu'il est musicien, qu'un jour il viendra jouer du violon rien que pour moi, pour me remercier. Un jour, oui... il viendra...
Sur mon bureau, le papier à lettre attend. La plume plonge dans l'encrier - Mon cher Félix...
Mado C.
…..
ESPIONNE, MÉTIER DE FEMME
Le père de Louise, officier dans l’armée française, avait toujours eu pour souci que sa seule fille bénéficie d’une excellente éducation. La mère de Louise, d’origine anglaise, le soutenait dans cet effort. Ainsi, Louise, à l’âge de vingt ans, parlait couramment l’anglais, l’italien et l’allemand. Elle avait des bonnes bases en latin et en grec, ce qui allait de pair avec une culture générale étendue. Ses parents recevaient beaucoup. Elle était ainsi habituée aux mondanités et à l’aise en société. Elle poursuivait des études de l’histoire de l’art à la Sorbonne.
Dès août 1914, son père partit au front. Quelques lettres de lui parvinrent à Louise et sa mère, des lettres assez banales. Louise était déçue en les lisant. Pour Noël, le père rentra en permission. Sa fille lui reproche alors le style morne de ses lettres. Il lui répondit qu’il ne pouvait rien écrire d’intéressant car ses lettres risquaient de tomber entre les mains de l’ennemi.
Comment ça ? demanda Louise. Son père lui expliqua que des nombreux espions se trouvaient sur le territoire français. Ils étaient partout. Ils ne se distinguaient pas du reste de la population, il pouvait s’agir du facteur, d’un voisin, du garçon du bistro. Certains étaient recrutés par les Allemands, d’autres, parlant un excellent français, étaient infiltrés, mais tous transmettaient des informations à l’ennemi.
Louise ne dormit pas de la nuit. Être espionne ! Quel métier excitant ! Elle se voyait déjà décorée de la croix de guerre pour le courage avec lequel elle s’était impliquée dans sa mission, pour l’efficacité avec laquelle elle travaillait. Dès le petit déjeuner, elle harcela son père : elle voulait être espionne. Son père blêmit.
« Non, dit-il, c’est trop dangereux. Tu restes ici, à Paris, à poursuivre tes études. »
Elles lui paraissaient subitement d’un ennui sans bornes, ces études de l’histoire de l’art. Que du temps perdu, alors qu’elle pourrait être utile à la France et contribuer à sa victoire.
Ils étaient encore en train de discuter qu’un ami du père, lui aussi officier, arriva à la maison. Imprudent et énervé, le père lui lance : « Ma fille est devenue folle. Elle veut être espionne».
« Mais c’est une idée excellente, dit l’ami. Justement, l’État-major des armées cherche une jeune femme délurée, intelligente, qui présente bien pour l’envoyer à Berlin. »
« A Berlin ! Mais c’est de la folie ! Jamais de la vie » répond le père. « C’est ton devoir patriotique » dit l’ami avec raideur.
Iliola K.
LA VEUVE
Elle l’a vu partir Puis tout s’est écroulé
Un jour du mois d’août Le maire est venu lui annoncer
Il lui a dit avec un sourire est mort au champ d’honneur
Je reviens, pas de doute Ce jour là elle poussa un cri d’horreur
Puis le temps s’est écoulé Elle ne le verrait plus
Chaque jour elle s’est occupée Il est là haut en terre inconnue
De la maison et des enfants Elle prit la couleur du noir
Des animaux et des champs Celle qui marque le désespoir
Au début elle recevait des nouvelles Être veuve à vingt ans
Le facteur criait Annabelle À l’âge de l’éternel printemps
Une lettre des tranchées Quel sera son avenir
Tu vois il ne t’a pas oublié Aujourd’hui elle ne voit que le pire
Bernard B.

/image%2F2034508%2F20160830%2Fob_8befea_1009194.jpg)
/image%2F2034508%2F20230602%2Fob_b049f3_2023.jpg)